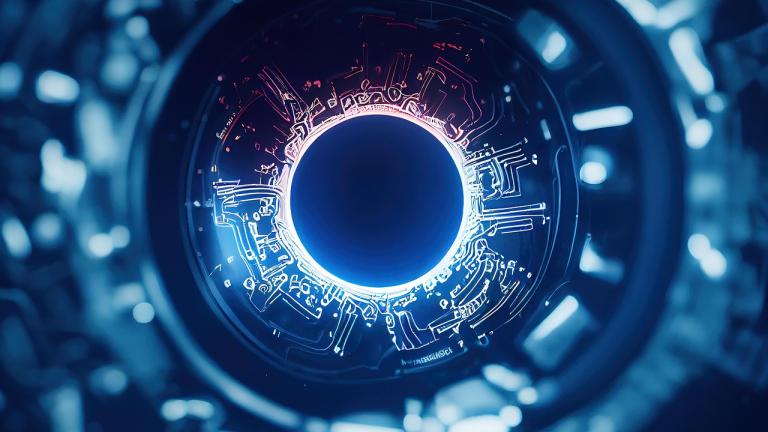"Le regard de l'analyste" : La titrisation - enjeux et perspectives en Europe
Temps de lecture : min
La titrisation est une technique financière apparue durant les années 1970 qui consiste transformer des crédits distribués par une banque en titres de créances, l’opération consistant à regrouper certains types d’actifs pour les restructurer en titres portant intérêts.
Le paiement des intérêts et du principal sur ces actifs est ensuite transféré à un investisseur (banques, fonds de pension…). Cette technique a pour avantage de transformer des crédits bancaires en titres financiers négociables, permettant la sortie comptable d’une partie de leurs crédits au bilan pour en accorder de nouveaux, et répéter ainsi le processus de titrisation. En transférant une partie du risque de crédit hors du bilan, la titrisation représente un levier pour améliorer les ratios de solvabilité.
En Europe, la titrisation suscite un intérêt croissant, malgré les stigmates de la crise des « subprimes » de 2008 (lorsque des prêts hypothécaires risqués, parfois notés AAA, ont été vendus de manière opaque aux investisseurs). Le rapport Draghi, publié en septembre 2024 et qui aborde l’incapacité de l’épargne élevée à rester sur le continent européen pour se diriger vers des investissements productifs, a toutefois réveillé l’intérêt de la titrisation, dans un contexte où les besoins de financement pour la transition écologique et technologique se chiffrent en centaines de milliards d'euros. En facilitant la sortie comptable d’une partie des crédits inscrits au bilan, la titrisation représente une solution pour libérer du
capital des bilans bancaires et accorder de nouveaux financements.
La BCE elle-même semble avoir un intérêt au développement de la titrisation, qui pourrait jouer un rôle central dans l’Union des marchés des capitaux, et permettrait également de remédier à la faible profondeur des marchés européens. Le Conseil des gouverneurs de la BCE, dans une déclaration de mars 2024 sur les progrès vers l’Union des marchés de capitaux, souhaite que « le marché de la titrisation de l’UE puisse jouer un rôle dans le transfert des risques en dehors des banques afin de leur permettre de fournir davantage de financement à l’économie réelle, tout en créant des opportunités pour les investisseurs ».
L’émission annuelle de titrisations au sein de l’UE ne représentait que 0,3% du PIB en 2024, contre 4% aux Etats-Unis. Cette différence s’explique
principalement par un cadre réglementaire européen plus contraignant, qui alourdit les coûts opérationnels des banques et réduit l'attractivité des produits titrisés. En particulier, la charge en capital est plus élevée pour les banques européennes lors des opérations de titrisation. Par exemple, une banque européenne devra immobiliser environ 10 M€ de capital réglementaire pour 100 M€ d’une tranche senior STS (Simple, Transparente, Standardisée) détenue, alors que l’exigence de fonds propres ne pourra être que de 7 M$ pour une banque américaine détenant 100 M$ d’une tranche senior AAA RMBS (« Residential Mortgage-backed security ») et se reposant sur des modèles internes (utilisés avec moins de contraintes qu’en Europe). Aujourd’hui, de nombreuses banques du vieux continent plaident pour une révision des charges de capital imposées afin de refléter le niveau réel de risque, tout en garantissant une supervision rigoureuse pour ne plus répéter les erreurs de 2008. Du côté des « originateurs », l’actuel régime européen de la titrisation (datant de 2017) impose un alignement des intérêts via une règle de rétention de 5% pour la banque à l’origine de l’opération de titrisation (les banques doivent conserver à leur bilan une part minimale du risque pour éviter une déresponsabilisation). De plus, les acteurs européens misent sur la participation d’agences de notation locales, capables de mieux évaluer les spécificités économiques et réglementaires de la région. Une telle approche renforcerait la souveraineté financière de l’Europe et réduirait sa dépendance aux agences américaines.
Cependant, deux facteurs peuvent contrarier le développement des produits titrisés en Europe. D’abord, l’éventuelle préférence des investisseurs européens pour les obligations sécurisées (« covered bonds »). Mais surtout, dans la première économie de la zone, la majeure partie du financement des entreprises repose sur des banques régionales, qui ont historiquement eu tendance à pratiquer une titrisation « au bilan » (« on balance sheet securitization »), en gardant les prêts titrisés au bilan (et la relation client), ce qui empêche la réduction de la charge en capital et la hausse de la capacité de financement de la banque. La titrisation « au bilan » peut toutefois fonctionner comme une titrisation classique (« true sale securitization »), grâce au recours à des opérations de SRT synthétiques (« Significant Risk Transfer ») ou transfert de risque significatif, opération « synthétique » car l’opération n’entraîne pas un transfert légal de titres, qui restent au bilan de la banque, mais uniquement un transfert de risque par la vente du risque de crédit lié, via des dérivés. L’appétit croissant des banques européennes pour la titrisation mais leur volonté concomitante de conserver les prêts au bilan a conduit à un rapide essor de ces opérations de SRT, si rapide que la BCE a appelé, en novembre, à la vigilance sur ce type d’opération (après en avoir simplifié leur supervision en 2025, par la réduction des délais
d’approbation des opérations…). La valeur au bilan de ces titrisations synthétiques représenterait actuellement 670 Md$ au bilan des banques européennes selon Bloomberg. La BCE et le FMI y voient désormais de nouvelles voies de contagion et une amplification du risque de contrepartie.
Le risque de crédit, externalisé via ces opérations plutôt complexes de SRT synthétiques auprès de fonds de dette privée et de hedge funds, est ensuite porté par une multitude d’acteurs financiers, dont des assureurs, de manière parfois opaque.
Le développement de la titrisation en Europe pourrait faciliter le financement par ses banques de la transition écologique et d’autres secteurs stratégiques (défense, infrastructures…), à condition, notamment, de maintenir l’attrait des investisseurs pour des produits titrisés transparents. Les problématiques d’accès aux financements sont une thématique que nous suivons dans le cadre de nos Perspectives Économiques et Financières.
Rédigé par

Cyril BRUNET
Analyste financier et extra financier